À toutes nos lectrices et tous nos lecteurs, le Conseil d'administration de la Société d'histoire du Haut-Richelieu offre ses meilleurs vœux pour un très joyeux Noël.

La Société propose ici de courts textes relatant des faits marquants de notre histoire régionale ainsi que de brèves biographies de personnages ayant façonné, hier, notre société d'aujourd'hui. NOTE IMPORTANTE : La publicité qui paraît désormais dans nos pages n'est pas de notre fait et nous ne la cautionnons en aucune manière.
mardi 25 décembre 2018
mardi 18 décembre 2018
LE FORT CONSTRUIT AVEC LA PIERRE ENNEMIE…
À peine signé, en 1814, le traité de Gand[1]
mettant fin à la guerre de 1812 entre les États-Unis et la Grande-Bretagne,
semble déjà sur le point d’être violé.
Les forces d’occupation
britanniques sentent immédiatement le besoin de renforcer les défenses, surtout
pour protéger les approvisionnements du Haut-Canada, jugé plus précieux car
majoritairement anglophone.
Et, cette protection passe
nécessairement par la défense de Montréal, maillon capital protégeant la voie
fluviale du Saint-Laurent.
Or, il semble évident aux
stratèges que Montréal toute seule ne saurait pas se défendre adéquatement et
qu’il faut au moins bloquer entièrement le Richelieu afin de protéger la ville.
Mais une question épineuse se
pose : faut-il continuer à miser sur une éventuelle suprématie navale – ce
qui a été ruineux lors de la guerre de 1812 – ou faut-il plutôt miser sur des
défenses terrestres?
Toutes choses considérées, la
voie terrestre est privilégiée, surtout que les Étatsuniens semblent beaucoup
mieux équipés côté construction marine et qu’ils ont justement érigé un fort[2]
à Rouse’s Point, près de frontière là où le lac Champlain se déverse dans le
Richelieu.
Après de longues tergiversations,
la décision est prise de construire un fort de pierre dans l’Île aux Noix et
les travaux sont lancés en 1819.
Désireuse, dans la mesure du
possible, de n’avantager que des compatriotes, l’armée se tourne vers des
entrepreneurs qui, souvent, ont été d’anciens soldats ayant conservé de solides
liens avec la hiérarchie militaire et qui sont susceptibles de profiter de
renseignements privilégiés.
Dans le cas de Peter Rutherford,
il s’agit d’un commerçant de Montréal bien en selle dans les milieux huppés.
C’est lui qui est choisi pour
fournir la pierre devant servir à la construction de la forteresse.
Bien sûr, il y a bien de
nombreuses carrières au Bas-Canada, mais y recourir avantagerait des
entrepreneurs canadiens français, ce qui n’est pas du goût des anglophones.
Rutherford préfère contacter ses
liens d’affaires au Vermont et, alléguant que les carrières
canadiennes-françaises sont trop éloignées et que le coût du transport serait
prohibitif, il achète sa pierre à une carrière de l’île La Motte, en plein
territoire ennemi…
Quand on dit que l’argent n’a pas
d’odeur…
mardi 11 décembre 2018
MORT D’UN GÉANT
En ce 12
décembre 1958 décède à l’Hôtel-Dieu de Montréal le célèbre docteur Roméo
Rochette, fondateur et chef du service d’anesthésie de ce même hôpital.
Né dans la
paroisse de Saint-Cyprien-de-Napierville en 1895, Roméo Rochette était fils et
petit-fils de médecins.
C’est donc
presque « naturellement » qu’après de brillantes études au Collège de
Montréal il s’inscrit à la Faculté de médecine de l’université de Montréal (qui
vient tout juste de se détacher de l’université Laval de Québec) où il décroche
son doctorat en médecine (M.D.) en 1922.
 |
| Hôtel-Dieu Source : Jacques Nadeau - Le Devoir |
Interne à
l’Hôtel-Dieu dès 1921, il devient chef interne 3 ans plus tard avant de se
faire offrir un poste non rémunéré d’assistant anesthésiste toujours au même
hôpital.
Pour arriver à
boucler son budget, il se voit toutefois forcé de renoncer quelque peu à cette
spécialisation et d’ouvrir un cabinet de médecine générale, expérience qui lui
déplaisait et dont le tire l’anesthésiste de l’hôpital, le docteur Charles
Larocque.
Celui-ci lui
offre en effet en 1927, une rémunération suffisante qui rendait son cabinet
superfétatoire et qui lui permettait de se consacrer à temps plein à
l’anesthésie, discipline tout à fait nouvelle à l’époque et qui pose alors ses
solides fondations scientifiques.
Il s’agissait en
fait de remplacer le docteur Adrien Larose, bras droit officiel de Larocque,
mais bras droit tellement diminué par la maladie qu’il est presque
perpétuellement absent.
Rochette déploie
alors dans son nouveau poste un tel enthousiasme, un tel dévouement envers les
patients et un tel souci de suivre au plus près les découvertes et les percées
technologiques dans son domaine de prédilection qu’en 1934, après la mort de
Larocque et de Larose, il devient bien entendu le chef anesthésiste de
l’établissement.
En fait, c’est
un véritable service d’anesthésie qu’il fonde alors et auquel il va assurer une
très grande réputation.
À un point tel,
d’ailleurs, qu’en 1943, lorsque les anesthésistes de l’époque décident de se
doter d’une association professionnelle – la Société canadienne des anesthésiologistes – Roméo Rochette en
devient vice-président fondateur, ce qui illustre bien la cote d’estime dont il
jouissait auprès de ses pairs.
C’est peu de dire
que son décès en 1958, à 63 ans, a été durement ressenti par toute la
profession, car c’était un pan entier de sa construction et de son histoire qui disparaissait ainsi.
mardi 4 décembre 2018
LE DÉCÈS DU GEÔLIER
Comme chacun sait, les geôliers
ont en général mauvaise réputation et sont mal aimés de la population.
Ce n’était en tout certainement pas
le cas de Domina Goyette, geôlier à la prison longtemps installée à l’arrière
du Palais de justice.
À preuve, le Canada français du
31 mars 1949 souligne de façon marquée le décès de cet agent hors norme.
Monsieur Goyette était réputé
pour tous ses égards envers les prisonniers sous sa garde, allant même à l’occasion
jusqu’à leur offrir des repas de gala sur une table expressément dressée pour
eux.
Il était aussi réputé pour ses
excellentes relations avec tout le personnel de l’appareil judiciaire, de telle
sorte que lors de ses obsèques, ce sont véritablement le ban et l’arrière-ban
des fonctionnaires de justice qui ont tenu absolument à faire acte de présence.
Fait à noter, ces égards n’étaient
pas uniques, car l’année précédente, le Canada français du 2 décembre 1948,
déjà, signalait comme à regret le départ à la retraite de ce fidèle serviteur
du bien public.
À ce moment, le Barreau, les
magistrats et le protonotaire… tous s’y sont mis pour souligner ses mérites et
pour lui offrir une bourse en marque d’appréciation.
On serait bien étonné, de nos
jours, de voir un tel déferlement de considération.
mardi 27 novembre 2018
QUANT ON BÉNISSAIT LES NOUVELLES RUES
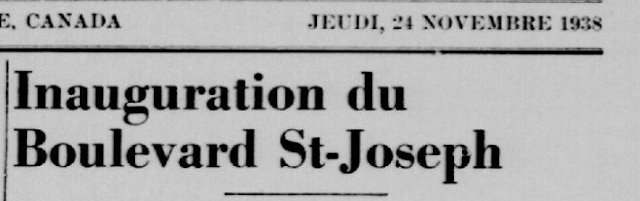 |
| Source : Canada français |
En ce 20 novembre 1938, la ville
de Saint-Jean est en liesse.
Le tant attendu nouveau boulevard
Saint-Joseph, qui relie le boulevard du Séminaire à la rue Champlain, est
finalement inauguré.
Le besoin de cette nouvelle
artère était en effet évident depuis qu’on lui avait fixé 3 objectifs :
sécuriser l’accès à l’école du lieu, faire travailler les chômeurs et, surtout,
offrir un nouveau pôle d’attraction pour les investisseurs et les entreprises si
nécessaires au développement économique de la collectivité.
En ce beau dimanche, donc, une
bonne partie de la population jeannoise s’est rendue sur place pour écouter les
politiciens pérorer sur leurs éminentes qualités et sur les services qu’ils ont
rendus à la population grâce à leur opiniâtreté…
Puis arriva en grande pompe l’évêque
Anastase Forget venu en personne bénir cette nouvelle voie, ce qui lui rappelle que le chrétien, justement, chemine tout le long de
sa vie.
Et d’avoir choisi comme patron de
cette voie le père adoptif de Jésus lui semble aussi d’excellent augure.
L’histoire ne dit toutefois pas
si cette intervention diocésaine a facilité ou accéléré l’atteinte des 3
objectifs visés à l’origine.
mardi 20 novembre 2018
UNE GRANDE ERREUR ARCHÉOLOGIQUE...
De temps immémoriaux, une vieille
épave gisait au fond de l’eau tout juste devant le Fort Saint-Jean.
 |
Canada français, 14 octobre 1898 |
À peu près personne ne s’en
souciait sauf les plaisanciers qui devaient s’en méfier doublement à cause de
la puissance du courant à cet endroit.
Mais, en octobre 1898, il devient
urgent de déplacer ce débris, car il gêne le dragage de la rivière et en un
tournemain, sans grandes précautions, les restes sont soulevés et déposés sur
la rive.
L’archéologie n’étant pas une
passion dévorante à l’époque on abandonne le tout là, surtout que le navire a
manifestement été visité par des pilleurs qui ont emporté tout ce qui pouvait
avoir la moindre valeur monnayable.
À tout hasard, on laisse entendre
que la carcasse est celle du Royal Savage,
un navire militaire construit à Saint-Jean en 1775, sur ordre du gouverneur Guy
Carleton, pour affronter les troupes étatsuniennes d’invasion.
Ce deux mâts équipé en schooner
aurait été coulé par les troupes du général Montgomery lors de son attaque
contre le Fort Saint-Jean.
Fin de l’histoire, chez nous.
Mais, c’est compter sans la
détermination de la marine des États-Unis de recenser et de récupérer tous les
bâtiments sur lesquels ont flotté ses drapeaux.
Il s’avère en effet que le Royal
Savage a été renfloué par les troupes de Montgomery, remis en état et confié au
général Benedict Arnold, qui était chargé d’imposer sa loi sur le lac Champlain.
Le schooner a mené nombre d’attaques
avant de s’échouer à l’île Valcour.
Les Anglais l’ont alors repris,
incendié et abandonné lorsqu’il fut devenu inutilisable.
239 ans plus tard, en 1995, la marine des
États-Unis a récupéré ce qu’il en restait pour le protéger et le mettre en
musée.
Quant à l’épave du Fort
Saint-Jean elle semble totalement oubliée, car elle ne figure pas dans les
recensements d’épaves du Richelieu.
Inscription à :
Commentaires (Atom)








